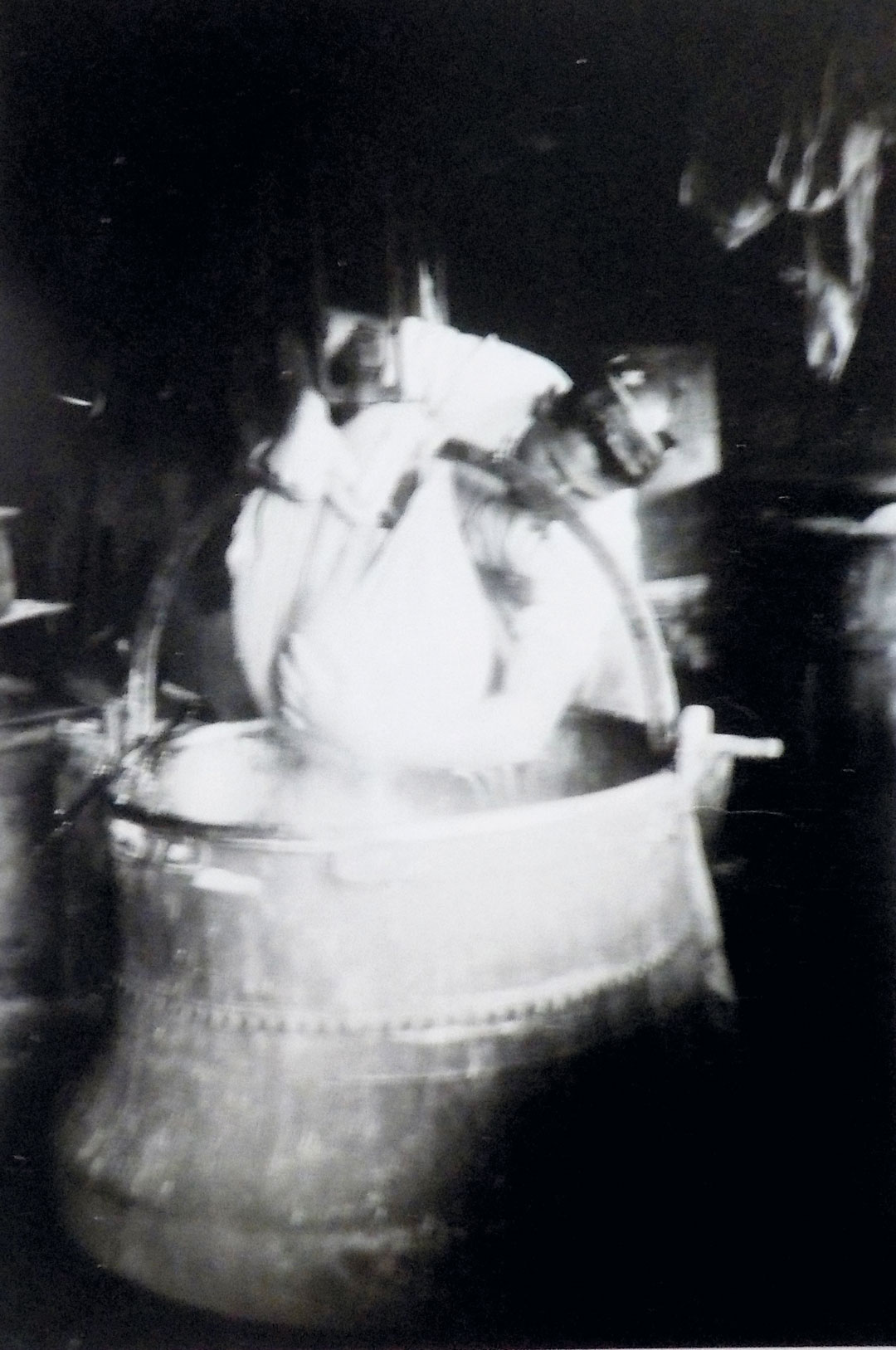J’avais cinq ans. C’était un dimanche, très exactement le 7 septembre 1952. Notre père, accompagné de ses trois fils, décidait de monter au chalet, voir à quoi l’on en était question de fromages. Dès la fin du village ayant emprunté la route de Mouthe, la pente est raide qui grimpe à Haut-des-Prés, plus rapide encore quand il s’agit d’affronter le chemin des Communs, à l’époque tout en terre blanche et perpétuellement raviné par l’orage. On arrive bientôt au sommet de la côte pour laisser derrière soi ce splendide paysage où prennent place nos deux villages du Pont et des Charbonnières, et nos deux lacs, pour le grand, juste le bout, laissant aux autres l’autre bout !
On est aussitôt dans un autre monde, celui des pâturages. Une porte s’est comme refermée sur notre vie courante pour nous en offrir une nouvelle où l’alpage tient désormais une place essentielle. On passe près du couvert du Chalottet. On prend aussitôt l’ancien chemin pour gagner le premier chalet. On ne s’y arrête pas parce qu’il est fermé, étant de rechange tandis que tous ces jours l’action se passe au chalet principal, le plus ancien des deux. Le chemin est encore long. A cet égard soit on passe par la Grand’Combe, alors on plonge en celle-ci pour se retrouver de l’autre côté où l’on remonte la côte, sécharde au possible, soit on prend le chemin neuf, qui vous fera rester à niveau presque jusqu’au bout. Où vous l’atteignez quand vous avez franchi une dernière petite côte et que tout soudain vous découvrez la grande clairière ronde au milieu de laquelle, sur une éminence, trône le chalet.
Il était là désormais, devant nous, but de la promenade, oubliant déjà la fatigue et l’ennui de cette longue approche pour découvrir ce que cette ancienne bâtisse au grand toit pyramidal pouvait nous offrir en terme de surprise. Non pour notre père bien sûr qui y avait fabriqué pendant douze ans, ni même pour mes deux grands frères, mais pour moi qui n’avait pas eu jusque là l’occasion de contempler ce chalet, ou tout au moins ne gardant plus aucun souvenir de visites précédentes.

C’est dimanche. Vers les trois heures. Y a du monde devant le chalet, sur un banc. On se reconnaît. On se salue. Mais bientôt aussi l’on rentre, car le fromager nous a invités à la cuisine. Ce qui frappe ici, c’est l’odeur. Elle est naturellement propre à ce type de bâtiment, alors que le troupeau est là, à l’écurie, couché, ruminant l’herbe broutée le matin, on l’avait rentré peu avant midi, tranquille alors qu’il fait si chaud dehors. Elle est complexe cette odeur. Elle est même multiple. Tout d’abord il y a celle du lait, plutôt du petit-lait, un peu aigrelette alors que la fabrication a eu lieu au début de la matinée. Mais il y a aussi l’odeur âcre de la fumée, de tous les jours mais avec en plus celle de deux ou trois bûches qui charbonnent encore dans le creux de feu et sous la chaudière. On aime volontiers à prolonger le feu du matin en septembre, tandis que tout commence à devenir froid. Et puis comme notre père, laitier, s’intéresse de savoir à quoi l’on en est avec les fromages, on ne tardera pas d’ailleurs à les descendre, on pénètre dans la cave. Attention, vite refermer la porte derrière soi à cause des mouches. Pour quant aux souris, elles trouveront toujours à découvrir un passage. On tend des trappes, sans que l’on évite qu’il n’y ait de temps à autre une ou deux pièces entamées. Ici, domine une forte odeur d’ammoniaque. Elle vous saisit tout entier. Elle est corsée mais garde néanmoins en elle des subtilités. C’est en fait une bonne odeur de fromage que l’on n’oubliera jamais. Elle nous donne l’envie immédiate de sortir le couteau et de se tailler une belle liche dans une pièce déjà ouverte qu’il y aurait pour la consommation des bergers. Elle nous accompagnera tout autant que les autres jusqu’à la fin de notre vie. Ne la pleurons pas cette dernière. On en aura découvert, des choses, et des situations, et des gens. On en aura joui, de ces lieux magnifiques de notre petite patrie combière. Et surtout l’on aura aimé ce chalet au-delà de toute raison.
L’ammoniaque, c’est l’odeur même de cette cave à fromage éclairée par trois petites borgnettes seulement, avec des treillis devant à cause des mouches. Et les vapeurs de sel s’incrusteront dans les murs, à tel point que du salpêtre ressortira en permanence dans le bas de la paroi de la cuisine, juste de l’autre côté, même trois quarts de siècle après l’arrêt des fabrications. Et le phénomène continuera à se poursuivre presque indéfiniment, à condition bien sûr que le chalet résiste après qu’il ait survécu à des centaines de gros orages au cœur de l’été. C’est, reconnaissons-le, un témoin précieux de la longue histoire du gruyère. Un admirable bâtiment, construit selon les critères de l’époque, avec une charpente chevillée et solide, noircie par toutes les fumées d’un si long temps, surtout en des époques où il n’y avait de plafonds nulle part. Une charpente qui ne bouge pas. Elle craque, plus encore la tôle du toit surchauffée quand un nuage passe devant le soleil. Et l’on voit sur ce même toit la grande cheminée qui fume encore de ces quelques braises sur lesquelles on a remis une ou deux bûches afin que les visiteurs du dimanche, après avoir tant transpiré, ne prennent pas froid.
La dernière odeur, plus forte, est naturellement celle de l’écurie. On ouvre la vieille porte, elle est aussi ancienne que le chalet lui-même, et l’on pénètre en ces lieux où les vaches se sentent bien. Combien en fait qui auront passé par là, combien de centaines, de milliers, qui toutes ont fait la même chose. On sent leur grand souffle chaud alors qu’elle vous regardent et se demandent ce que vous venez faire ici, car vous n’avez ni la tête du fromager ni celle de ceux qui l’aident. Et bien entendu vous n’êtes pas habillés de la même manière. Un gros pantalon de toile ou de futaine et un mandzon pour eux, les manches de la chemise retroussées, alors que vous autres, vous avez mis vos habits du dimanche à défaut d’une tenue plus adaptée pour la promenade. Dans une heure ceux-ci commenceront à traire.
On retourne à la cuisine. Vous prendrez bien un peu de crème, nous dit le fromager, un Suisse-allemand, un bon gaillard, très jeune encore, et qui pourtant a déjà la responsabilité de la fabrication. Il fera quelques années au chalet, l’hiver à la laiterie au village, et puis plus tard, non il ne restera pas berger, il s’engagera plutôt dans la police. On y a meilleur temps et bien entendu l’on y gagne mieux sa croûte que dans un chalet. L’administration, ça a du bon !
Il est allé chercher la crème à la chambre à lait. Il a pris avec lui un bidon d’alu dans lequel elle est épaisse. Elle est celle du matin. Il vous en tire une louchée pour chacun qu’il met dans votre bol. Je vois le mien, il est rouge, avec de gros pois blancs. On peut mettre un peu de sucre. On mange la crème avec des cuillères de bois. Le goût de celle-ci, tout en même temps cette odeur de fumée et d’écurie un peu, ça vous a quelque chose d’unique et de rassurant. On est autour de la vieille table, l’une de celles qu’a faites autrefois l’oncle Arthur. On est bien. On parle de la saison, bien sûr. Comment elle s’est déroulée. Pas trop mal, assez d’herbe, assez d’eau à cause de bons gros orages. Et pour quant aux fromages, ils seront sans doute jugés acceptables par le futur acheteur qui viendra les taxer la semaine prochaine. Henri Rochat-Golay du Pont ou son fils, les époques se mélangent. C’est là une famille de marchands avec laquelle on travaille depuis des décennies. Et même qu’ils ont comme tous leurs autres collègues de par le canton, cette manie de vous demander des bons poids à n’en plus finir. Ce sont des gros, des sûrs d’eux, et puis il y a la tradition. Alors on ne dit pas grand-chose tout en faisant le poing dans sa poche. Des choses comme ça.
Et cette crème, elle est fraîche et bonne, mais en même temps elle vous colmate vite l’estomac. On n’en reprendra pas une deuxième portion. Et puis voilà, à force de discuter, le temps passe. Il est quatre heures, et même un peu plus, car le dimanche on est un peu moins pressé. Alors on se salue tandis que le fromager et ses aides passent à l’écurie pour traire, déjà le botte-cul fixé avec la ceinture autour de la taille, et le seillon à la main, et que nous autres nous prenons le chemin du retour. Mais non pas tout de suite en direction du village. Plutôt un peu sur la droite quand l’on regarde en direction du Mont-Tendre. On se rendra à une cabane qu’il y a là-bas, à nouveau après un si long chemin me semble-t-il. Notre père a dû me tenir la main malgré qu’il se serve d’une canne pour marcher. Il n’a pas oublié sa casquette du dimanche. On arrive enfin. On ouvre la porte, et là, bientôt, avec une craie qu’il avait dans sa poche, notre père inscrit une date sur l’une des écorces de cet intérieur étrange à l’odeur de sève. Le 7 septembre 1952. Et non seulement il signe de son nom, mais aussi il met ceux de ses trois fils, l’un au-dessus de l’autre par ordre d’ancienneté. Pour quant au quatrième, il ne marche pas encore, et en conséquence il a dû rester à la maison.
Et voilà, ce fut une belle découverte, bien que le souvenir de cette promenade ait été plus intense longtemps après qu’elle fut réellement vécue. Où le retour, car il fallait arriver au village pour le souper, et ensuite pour mon père honorer le coulage du soir, fut long, si long, que je croyais quant à moi, avec les modestes guibolles que peut avoir un enfant de cinq ans, qu’on ne retrouverait plus jamais la maison. Le chalet était alors bien loin derrière et déjà oublié.
Ymer